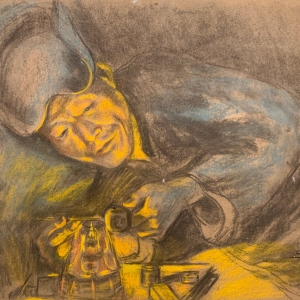Ainsi qu’au temps du Père, le soir venu, les femmes accompagnées de leurs marmots filent autour de moi, riant et jacassant pendant que les garçons jouent de leur viole. Puis vient la prière du soir, chantée par tous en longues mélopées d’une langue barbare.
Je leur laissai en souvenir mon phono et chaque soir, au retour des champs, dans un petit village montagnard, très loin, en Chine, les femmes filent en écoutant la musique française.
Tataï, ni pou you siao ouan-ouan (Madame, vous qui n’avez pas d’enfant), ni maé ouo ti (achetez le mien, voulez-vous) ? Lou che, pou maé (60 dollars, pas cher).
“Qu’est-ce que tu dis ? Tu veux me vendre ton bébé 60 Dollars, ta belle petite fille ! Mais tu n,y songes pas ! Et puis tu la nourris, elle tomberait malade, privée de ton lait.”
Je viendrai lui donner à boire quand toi vouloir. Son père, soldat, est licencié, et veut que je la vende.
Ne parles pas de cela, tu me fais horreur. Gardes ta fille, et songe que plus tard, lorsque tu auras un garçon, elle le portera.
Les yeux de la jeune femme s’illuminent. Un garçon ! Bien sûr qu’un garçon elle ne le vendrait pas mais une fille ! elle est trop pauvre vraiment.
Quelques semaines passent. La jeune chinoise, vêtue du deuil blanc traditionnel, entre chez moi, silencieuse, la démarche saccadée, à peine soutenue par ses pieds minuscules et torturés. De grosses larmes sillonnent ses joues.
Ta petite fille… morte ? Elle toussait dis-tu ?
Je la regarde soupçonneuse. J’évoque, attendrie, le souvenir de son beau bébé plein de vie. Je ne sais pas, je ne veux pas savoir, ce serait trop horrible si…
Elle cherche fébrilement dans mes cartons les études que j’ai faites de son bébé, puis s’éloigne, raidie, sans se retourner, un portrait de son enfant serré contre sa poitrine.